Vif, montagne d'Uriol, Varces |
La localité de Vif se situe dans le sillon subalpin de la bordure orientale du Vercors, à l'extrémité de la vallée septentrionale de la Gresse, là où elle débouche dans la plaine alluviale, six kilomètres en amont du confluent de cette rivière avec le Drac.
Au nord de Vif la crête de la montagne d'Uriol s'abaisse progressivement vers le nord pour disparaître finalement sous la plaine alluviale à l'emplacement même de Varces (c'est également à cette latitude que s'opère le confluent avec la Romanche, le Drac et la Gresse). Mais le crêt du Tithonique émerge de nouveau de la plaine alluviale peu au nord de Varces, à Rochefort, bien dans le prolongement de la crête d'Uriol (plus de détails à ce sujet à la page "Comboire").
C'est là aussi que débouche la vallée du Lavanchon, plus occidentale, qui descend de Saint-Paul-de-Varces en suivant la combe des couches marno-calcaires du Berriasien et des marnes de Narbonne, lesquelles sont recouvertes sur toute sa largeur par une nappe d'alluvions fluviatiles.
Au sud de Vif la vallée de la Gresse correspond plus précisément à une combe monoclinale ouverte dans les Terres Noires et encadrée par deux lignes de relief l'une et l'autre orientées N-S : à l'est l'échine très émoussée du Bajocien des deux Brions et à l'ouest la crête rocheuse acérée du Tithonique de la Montagne d'Uriol. L'une comme l'autre sont assimilables à des crêts* qui regardent vers l'est et qui s'intercalent de façon stratigraphiquement normale entre la couverture liasique du "dôme de la Mure" (voir la page "Conest") et les couches crétacées du revers oriental du Vercors.
 Les abords méridionaux de Vif (vallée de la Gresse), vus du nord d'avion depuis l’aplomb de Reymure. f.Co = faille (décrochement) de Cornage ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont. all.w. = alluvions fluvio-lacustres et glaciaires du colmatage wurmien de la vallée du Drac. Dans l'épaisse succession de la cuesta du Bajocien inférieur on a distingué 3 niveaux (comme dans les collines bordières de Belledonne) : les calcaires inférieurs, les marno-calcaires intermédiaires (Bjm) et les calcaires supérieurs (Bjs). |
Au total le colmatage alluvial du sillon subalpin, qui caractérise le Grésivaudan au nord de Grenoble, se termine donc là en se partageant en plusieurs diverticules qui sont autant de combes colmatées d'alluvions fluviatiles. Chacune correspond évidemment aux niveaux les plus tendres, marneux (Aalénien, Valanginien) et elles sont séparées par des échines N-S formées de terrains plus calcaires, donc plus résistants (Bajocien, Tithonique).
 Le sillon subalpin à la latitude de Vif, vu de l'est, depuis le Conest (sommet de Beauregard). ØCr = chevauchement des Crocs ; ØsA = surface du chevauchement de Saint-Ange ; ØEp = surface du chevauchement de l'Éperrimont ; f.A = faille de l'Arc ; f.Ch = faille des Charbonniers ; f.Bt = faille de Btrise-Tourte ; f.U = faille transversale extensive d'Uriol. Les hautes pentes du rebord subalpin (à l'ouest de Saint-Paul de Varces), sont décrites à la page "Col de l'Arc" et le prolongement méridional de la crête de la montagne du Pieu à la page "Éperrimont"). |
La montagne d'Uriol, qui s'allonge entre Varces et Vif, est un crêt regardant vers l'est dont le versant occidental est pratiquement constitué par une dalle structurale résultant de la dénudation de la surface sommitale du Tithonique. Elle est fortement pentée jusqu'à sa base et plonge directement sous les alluvions fluviatiles de la vallée inférieure du Lavanchon.
Au nord du col de la ferme d'Uriol sa crête, presque rectiligne et orientée N.25 est presque partout formée aussi par le Tithonique mais elle est constituée en plusieurs endroits par la barre du Séquanien, qui est remontée jusqu'à ce niveau à la faveur de cassures transversales. Au sud de cette ferme, où passe d'ailleurs la plus importante de ces failles, sa structure se révèle plus complexe en même temps que sont tracé la raccorde en baïonnette au flanc oriental de la montagne du Pieu.
Il s'agit apparemment de failles purement extensives - et non de décrochements - car le pendage de ces failles s'écarte beaucoup de la verticale ; elles sont plus tardives que le chevauchement de l'Éperrimont car elles le décalent verticalement à la ferme d'Uriol septentrionale et dans les pentes immédiatement au sud-ouest du pont de Vif sur la Gresse. |
C'est à la faveur du jeu de ces cassures que Tithonique du Rocher Saint-Loup se détache sur cette crête (alors qu'immédiatement plus au nord c'est le kimméridgien qui affleure). En fait cette faille du Saint-Loup décale la barre du Tithonique suffisamment vers le bas pour montrer qu'elle est tordue en un synclinal à axe plongeant vers le SW, visible dans le versant ouest de la crête, ce qui la rebrousse vers l'ouest en un crochon* bien caractérisé (voir le second cliché ci-après).
D'autre part, au sud de ce dernier, la barre tithonique est abaissée en contrebas de la crête : elle y disparaît du fait qu'elle y est rapidement coupée en biseau par la surface de chevauchement de la klippe* de l'Éperrimont. Les couches de la montagne d'Uriol disparaissent là du versant ouest de la montagne car elles passent en tunnel sous ce chapeau tectonique (voir à ce sujet la page "Éperrimont").
Au sud de la ferme d'Uriol l'ensemble de la succession qui forme la crête septentrionale d'Uriol se poursuit au flanc oriental de la montagne du Pieu (voir plus haut les photos de ce versant). Mais cela se produit au prix d'un décalage vers le bas par une faille d'Uriol inclinée à peu près à 45° vers le sud. À la faveur de l'abaissement de sa lèvre méridionale on voit que le Tithonique prolongeant celui de Saint-Loup s'y enfonce vers l'ouest sous de l'Argovien par le jeu du chevauchement de l'Éperrimont. On peut donc penser que le rebroussement synclinal de Saint-Loup correspond à un crochon induit par cet accident et que ce dernier devait donc s'y poursuivre.
Quoi qu'il en soit cette disposition détermine une ligne de replats déboisés, sorte de vire déterminée par la bande d'affleurements argoviens, qui se poursuit, en passant à l'ancienne cabane méridionale d'Uriol (point coté 757), jusqu'aux Rochers de l'Église Saint-Michel, au débouché oriental du vallon de l'Échaillon (voir la page "Éperrimont"). Au dessous de cette vire un ressaut boisé laisse voir, bien que de façon discontinue, le Tithonique représentant le sommet du soubassement du chevauchement de l'Éperrimont.
|
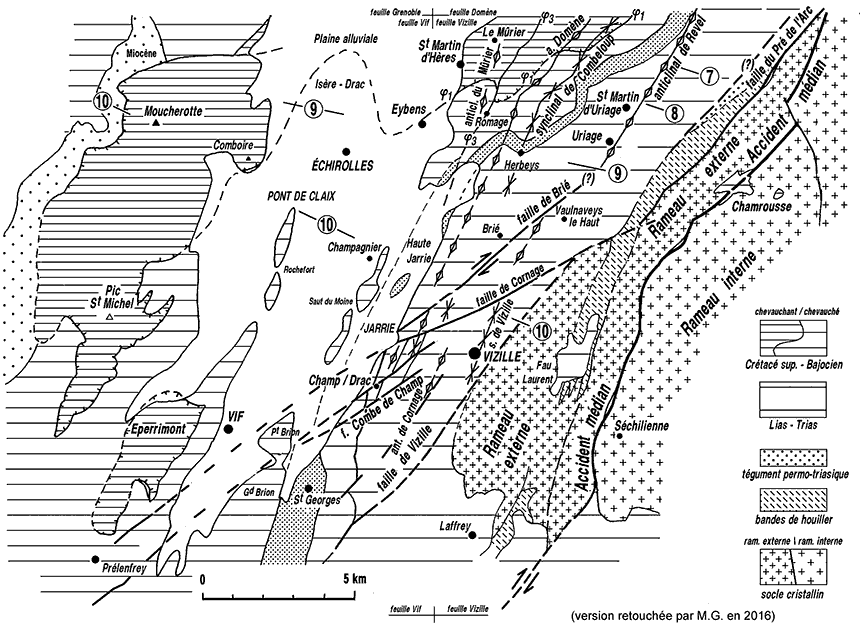 Carte simplifiée du cadre géologique des environs de Vif et de Vizille Cette carte montre que, entre Vizille et Vif, le sillon subalpin est traversé en diagonale par le prolongement sud occidental du faisceau de failles de Jarrie. Ce couloir de décrochement, orienté N45 à N50, traverse le socle et la couverture mésozoïque. Il possède à la fois un rejet de coulissement dextre, bien étayé par la cartographie générale et par l'analyse des plis dans le secteur de La Combe de Champ (fig. 6), et de soulèvement relatif du compartiment sud-est, que démontrent les relations entre la couverture et le massif cristallin au nord-est de Vizille. Aux abords de Vif cet accident se manifeste sans doute par le décalage de la barre du Bajocien calcaire entre les affleurements du Saut du Moine et ceux du Petit Brion, d'une part, et ceux du Grand Brion (Les Riperts), d'autre part. Puis il va se perdre dans le Néocomien de la bordure du Vercors aux abords de Prélenfrey. Il se manifeste peut-être encore par le faible décalage de la barre Tithonique au sud-est de ce village et on peut se demander s'il n'est pas en rapport avec l'interruption du système de redoublement de cette barre au sud de l'Éperrimont. Les emplacements des coupes de la planche de coupes sont indiqués par des chiffres cerclés. |
cartes géologiques au 1/50.000° à consulter : feuille Vif
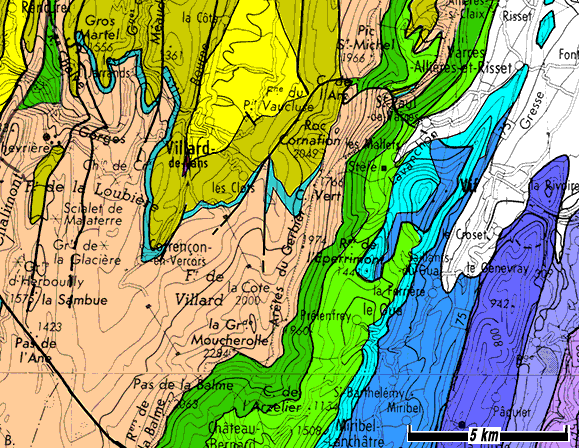 .
. 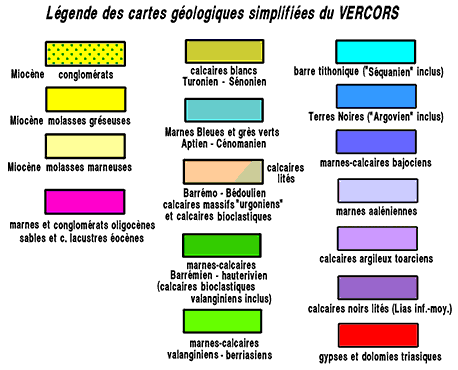
Carte géologique très simplifiée du rebord oriental du Vercors à la latitude de Villard de Lans et de Vif
redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°", par M. Gidon (1977), publication n° 074.
|
|
|
|
| (Cornafion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vif |
|