Cours aval de la Vernaison |
Le cours amont de la vallée de la Vernaison descend depuis le col Rousset vers le nord, en suivant le synclinal médian du Vercors. Mais la rivière, s'échappe de ce val jurassien* par un coude brutal vers l'ouest qui intervient 3 km au nord de La Chapelle-en-Vercors (à la latitude de Tourtre). Au delà de ce changement de direction son cours lui fait trancher presque orthogonalement la succession des couches du grand anticlinal des Coulmes.
La coupe stratigraphique de l'Urgonien (voir la page spéciale) montre là, en progressant vers le SE par rapport aux secteurs plus nord-occidentaux, un net épaississement de la série (qui dépasse ici 500 m) notamment au Barrémien inférieur. On y observe également l'invasion de ce dernier étage par des niveaux de calcaires bioclastiques (faciès de la formation de Glandasse). Les couches à Orbitolines (qui, plus au nord, séparent la masse supérieure de la masse inférieure), perdent leur caractère de niveau repère en se fondant dans la succession de la partie haute des falaises (à faciès urgonien proprement dit). |
La Vernaison franchit en premier lieu la barre urgonienne de ce flanc du pli en s'engageant, à partir du hameau des Baraques, dans de profondes gorges. La route D.518 est entaillée au flanc de leurs abrupts septentrionaux de ces dernières en un long encorbellement très spectaculaire, appelé les Grands Goulets.
Au delà de ces gorges la vallée inférieure de la Vernaison s'ouvre en une combe cernée de falaises qui est particulièrement large à l'endroit où elle franchit l'axe de la très ample flexure antiforme qui prolonge l'anticlinal des Coulmes. La direction du talweg (N.150) lui fait couper les plis fort peu obliquement à leurs axes (N-S), ce qui contribue à augmenter la longueur de cette traversée et à aplanir encore le dessin de la voûte urgonienne, déjà largement ouverte, de ces plis.
En rive gauche les prolongements de ces plis s'atténuent encore et le relief des escarpements montrent que la diversification des faciès au sein de la falaise urgonien s'effectue plus en amont (mais toujours assez rapidement) avec accentuation des niveaux marneux séparant les masses calcaires successives.
La barrière urgonienne de la rive gauche (occidentale) de cette typique boutonnière d'érosion ne subit aucune faiblesse jusqu'à sa retombée occidentale, où elle est crevée immédiatement à l'est de Sainte-Eulalie.
Par contre en rive droite cette carapace est crevée à son extrémité aval, à la faveur d'une ondulation anticlinale (anticlinal des Chartreux), de sorte que la dépression de la Vernaison communique avec celle de la Bourne par une combe anticlinale.
La grande analogie d'aspect du relief de la basse Vernaison avec celui de la vallée plus méridionale de Combe Laval suggère qu'elle a d'abord dû être, comme cette dernière, une reculée*, c'est-à-dire un cirque fermé à l'amont par une falaise et que son talweg n'a pas été créé par un cours d'eau à l'air libre mais qui s'est ouvert par effondrement de son plafond, sapé par les eaux souterraines. Les eaux provenant du cours supérieur de la Vernaison, qui s'y écoulent mainteant, ont dû seulement être capturées à la faveur du recul plus important du fond de cette reculée : la Vernaison a dû approfondir ensuite ces gorges des Grands Goulets pour rejoindre le niveau du fond du cirque par lequel elle s'échappait ainsi hors du val N-S de la Haute Vernaison. Dans les deux cas c'est donc l'érosion karstique qui a joué un rôle premier dans leur creusement. |
.
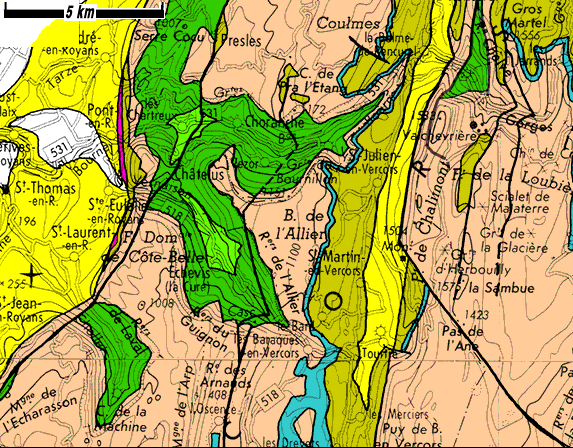
Carte géologique très simplifiée des vallées aval de la Bourne et de la Vernaison
redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°", par M.Gidon (1977), publication n° 074.
![]() légende
des couleurs
légende
des couleurs
|
|
|
|
| Royans | LOCALITÉS VOISINES | Saint-Martin |
|
|
|
|
|
|
Vernaison aval |
|