| Montagnes de la Glière de Champagny |
En rive gauche des sources du Doron de Champagny le prolongement oriental de la crête du Grand Bec prend un relief particulièrement déchiqueté à partir du col du Tougne : il s'y termine avec les arêtes aériennes de la Glière et de l'Épéna qui sont constituées par la couverture sédimentaire de la partie la plus orientale du socle cristallin de la Vanoise septentrionale. La hardiesse de ces arêtes tient d'abord à ce qu'elles sont formées de couches qui sont proches de la verticale, du fait de leur situation le long de la retombée méridionale de la coupole de socle cristallin de la Vanoise septentrionale. En outre ces couches sont particulièrement massives et résistantes puisque formées soit par les quartzites triasiques (Grande Glière) soit par les marbres du Malm (Pointes de l'Épéna).
Le versant septentrional de ces crêtes correspond aux escarpements de rive gauche de la vallée supérieure du Doron de Champagny. À l'ouest de la Grande Glière ils sont formés presque en totalité par le socle cristallin de la Vanoise septentrionale qui arment le chaînon du Grand Bec. Sur toute sa longueur le pendage des termes successifs de ce matériel siliceux paléozoïque se montre beaucoup plus fort que l'inclinaison de la pente topographique. Il en résulte que ses couches s'y succèdent depuis les plus récentes jusque aux plus anciennes lorsque l'on s'éloigne de la crête vers le bas du versant. Enfin le pied de ce versant correspond à la partie tout-à-fait amont de la vallée du Doron, laquelle suit sensiblement la limite nord-orientale de ces affleurements de socle.
Le versant méridional de ces crêtes (celui de Pralognan) montre, de fait, que la couverture "autochtone" du socle cristallin de la Vanoise septentrionale y plonge à la verticale, et même un peu au-delà, en formant le flanc nord du synclinorium de Pralognan (voir les pages "Bochor" et "Grand Bec"). |
Deux faits marquants concernent cette limite nord-orientale du socle du Grand Bec dans la partie amont de la vallée du Doron de Champagny.
- Le premier est que la surface qui lui correspond sectionne en biais les termes successifs de l'épaisse lame rocheuse qui constitue le chaînon du Grand Bec. De ce fait cette dernière s'effile progressivement d'ouest en est, ce qui la conduit à se terminer en sifflet à son extrémité orientale, où elle ne constitue plus que la Pointe de Rosolin.
- Le second est que, dans sa partie située en amont du hameau du Grand Chalet jusque aux abords de la Pointe de Rosolin, cette surface met directement en contact les divers niveaux du socle cristallin (en succession renversée) avec le matériel (essentiellement liasique) de la nappe de la Grande Motte. Ce fait présente un caractère a priori paradoxal puisque les principaux affleurements de ce dernier domaine sédimentaire s'observent largement (et principalement) du côté opposé du chaînon Grand Bec - Glière, où ils constituent le chaînon de la Grande Casse.
L'explication de cette contradiction apparente repose sur l'analyse des abords de la Pointe de Rosolin. On y voit en effet que la surface de contact entre les deux ensembles rocheux y dessine une forte flexion en se moulant sur la terminaison orientale des affleurements de socle du chaînon du Grand Bec. C'est la charnière d'un pli, que l'on peut appeler l'antiforme de Rosolin, qui raccorde deux flancs redresés en sens opposé de cette surface : l'un, au nord, passe aux Caves de la Plagne et l'autre, au sud, va passer au col de la Grande Casse (voir la page "col de la Vanoise").
Le paléozoïque affleurant au cœur de ce pli disparaît en tunnel, par plongement sous le matériel de la Grande Motte qui constitue les Rochers de Pramecou, en s'enfonçant vers l'est selon son orientation axiale E-W. Mais cette surface ne correspond pas à un anticlinal affectant aussi le matériel du socle car elle tranche au contraire les strates de ce dernier. Elle le fait d'ailleurs selon un angle tel que le sédimentaire liasique qui garnit le flanc nord de cet antiforme de Rosolin y repose sur des micaschistes disposés à l'envers.
L'origine de cette géométrie énigmatique n'a encore fait l'objet d'aucune interprétation (voir cependant la page "tectonique de la Vanoise"). Quoi qu'il en soit elle semble affecter le matériel de la Grande Motte car le contour qui limite ce dernier, du côté oriental par rapport à la nappe des Gypses décrit un vaste bombement antiforme concentrique.
A la faveur de l'antiforme de Rosolin les affleurements du Lias de la nappe de la Grande Motte (qui forment aussi la Grande Casse) contournent ainsi par l'est (en rive droite du vallon de Pramort) les crêtes de L'Épéna et la Pointe de Rosolin puis se poursuivent, par la crête herbeuse des Eysserandes, jusqu'au plan des Glières.
image sensible au survol et au clic |
Du côté nord du vallon du Doron de Champagny (en rive droite à l'ouest du Grand Chalet) il est difficile de savoir jusque où exactement se poursuivent les affleurements de la nappe de la Grande Motte et ceux de la nappe des Gypses car ils y disparaissent sous une énorme masse d'alluvions glaciaires dont la crête forme le rebord du plateau des alpages de La Plagne et des Barmés. Le dessin cartographique de ce corps sédimentaire quaternaire, concave vers le sud-est autour des plans alluviaux de la Glière et de Pramort, montre qu'il s'agit d'une ancienne moraine latérale de rive droite du glacier de Prémou, d'âge sans doute fini-wurmien (ou remontant peut-être seulement au "Petit âge de glace" ?).
Plus à l'ouest, en rive gauche du Doron, la surface du socle siliceux du Grand Bec se montre encore couverte par un dernier affleurement de matériel liasique. Situé au niveau du chalet de La Motte, il déborde en rive gauche du Doron de Champagny et y revêt l'aspect d'un chevron rocheux clairement plaqué sur les dalles de micaschistes des pentes inférieures des Plattières. Plus en aval, à partir du hameau du Grand Chalet, le talweg du Doron ne s'inscrit plus que dans les micaschistes du socle cristallin (cf. carte en fin de page).
Au delà de ce point, à l'ouest de la crête secondaire qui descend de la Roche du Tougne, la surface supérieure du socle cristallin supporte plusieurs autres affleurements sédimentaires. Ils sont présents dans les pentes déjà élevées de La Mande, où ils déterminent surtout le plateau suspendu de la Saulire (voir la page "Grand Bec"), mais ne descendent pas vers le bas qu'insuffisamment pour atteindre le lit
du Doron.
Il est surtout remarquable qu'ils
sont de nature tout-à-fait différente puisque constitués de Malm
et de Crétacé supérieur reposant à l'endroit sur le socle cristallin. Tout ceci plaide pour y voir le prolongement, en rive gauche du Doron, de la couverture, adhérente au socle, du soubassement du massif de Vallaisonnay.
En particulier l'étroite bande de ces couches qui en descend dans les pentes de la Mande semble tout-à-fait comparable à celle qui descend verticalement le long du flanc sud-est de l'anticlinal de Vallaisonnay (voir la page "Vallaisonnay"). Il est peut-être signficatif qu'elle se dispose assez exactement dans le prolongement présumé du tracé de la faille du Col du Palet qui, en rive droite (entre Les Barmés et La Louza), limite du côté NW l'extension de la nappe des Gypses. |
Il est en définitive remarquable que, depuis la Pointe de Rosolin jusqu'à la Sauvire (voir la page "Grand Bec"), des couches mésozoïques, disposées d'ailleurs à l'endroit, affleurent en placages sur le versant nord-oriental du chaînon du Grand Bec. Or les couches paléozoïques de ce dernier (sur lesquelles les premières reposent) sont subverticales ou renversées, mais disposées avec leur base vers le nord-est, c'est-à-dire en polarité stratigraphique absolument inverse. Cette géométrie cartographique, très intrigante, est simplement attribuée, sur la carte géologique au 1/50.000 Moûtiers, à la prolongation de la surface de charriage de la nappe de la Grande Motte, laquelle est explicitement tracée, plus à l'est (jusque à Rosolin) sur la feuille Tignes.
Pour rendre compte de la géométrie paradoxale de ce secteur des environs de La Glière on peut envisager une première explication : elle consisterait à y voir un chevauchement d'ouest en est qui serait maintenant renversé et dont le bord frontal correspondrait au biseau qui sectionne la lame de socle à Rosolin. Ce chevauchement pourrait se poursuivre plus au NW par le Collet de la Becquetta, puis par le Plan des Gouilles, pour se raccorder à celui de Mio en rive NE du Doron (voir la page "Champagny"). Mais il ne semble pas y avoir beaucoup d'arguments de terrain pour étayer la présence d'un tel accident compressif. En effet, autour du Plan de la Glière, ce contact peut tout aussi bien correspondre à un simple repos stratigraphique des couches du Lias sur celles du socle. Cette hypothèse est d'autant plus envisageable qu'en plusieurs points (notamment à La Motte) on trouve, entre les calcaires argileux du Lias et les schistes cristallins, une brèche marbreuse à éléments dolomitiques. Une autre explication paraît dès lors envisageable, savoir que ces couches jurassiques se seraient déposées en onlap sur une surface de paléofaille extensive sectionnant en biais la dalle de socle du Grand Bec avant qu'elle ait été basculée vers le SW (voir la page "Tectonique de la Vanoise"). En tous cas, force est donc de constater que l'interprétation des rapports entre la nappe de la Grande Motte et les autres unités paraît tout-à-fait incertaine dans ce secteur (comme dans d'autres d'ailleurs ...) et qu'elle mériterait d'être ré-envisagée à la lumière de nouvelles recherches ... |
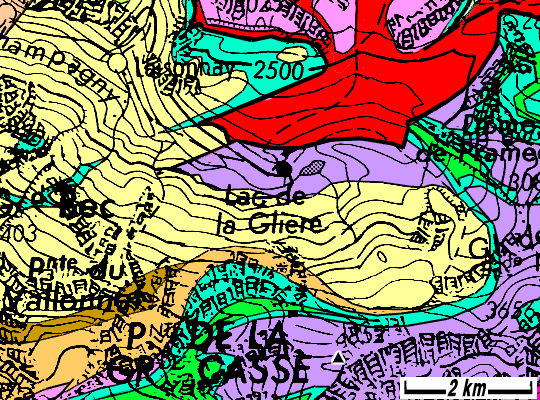
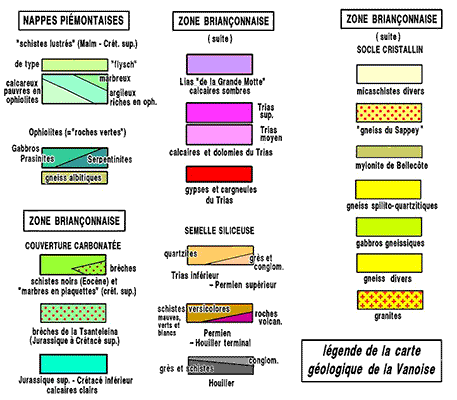
N.B. : Sur cette coupure de la carte on a représenté par un trait gras la surface du charriage de la nappe de la Grande Motte qui correspond à ses limites nord et est. Par contre du côté ouest cette surface devrait théoriquement limiter le domaine où affleure du Lias de la nappe par rapport à celui où les couches sédimentaires reposent sur le socle cristallin. Mais nulle part il ne semble possible de reconnaître que cette une limite correspond à une surface de charriage avérée. |
|
|
|
|
| Mont Bochor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glieres |
|